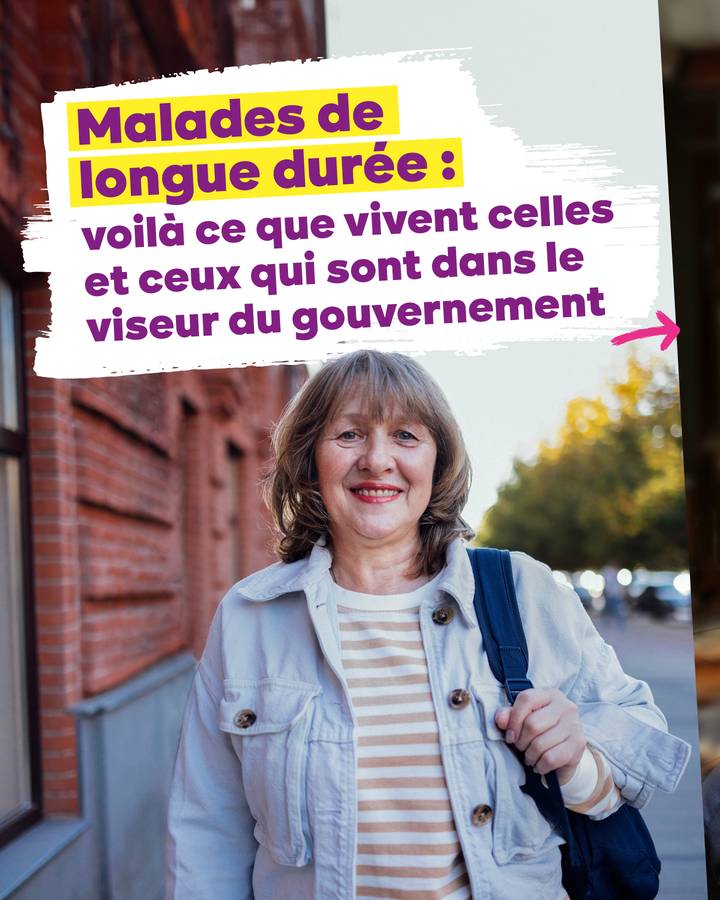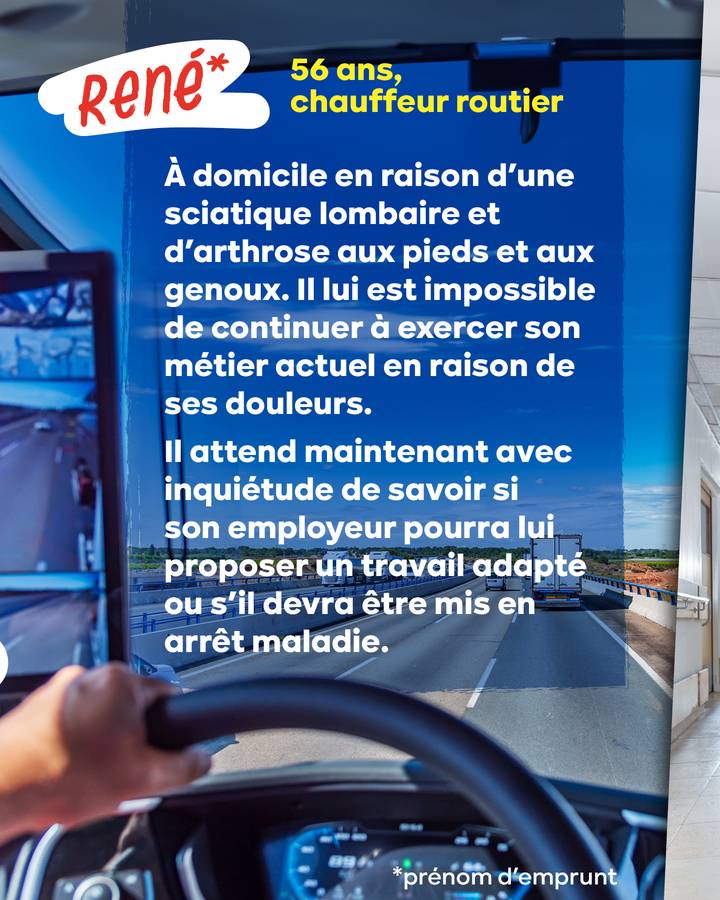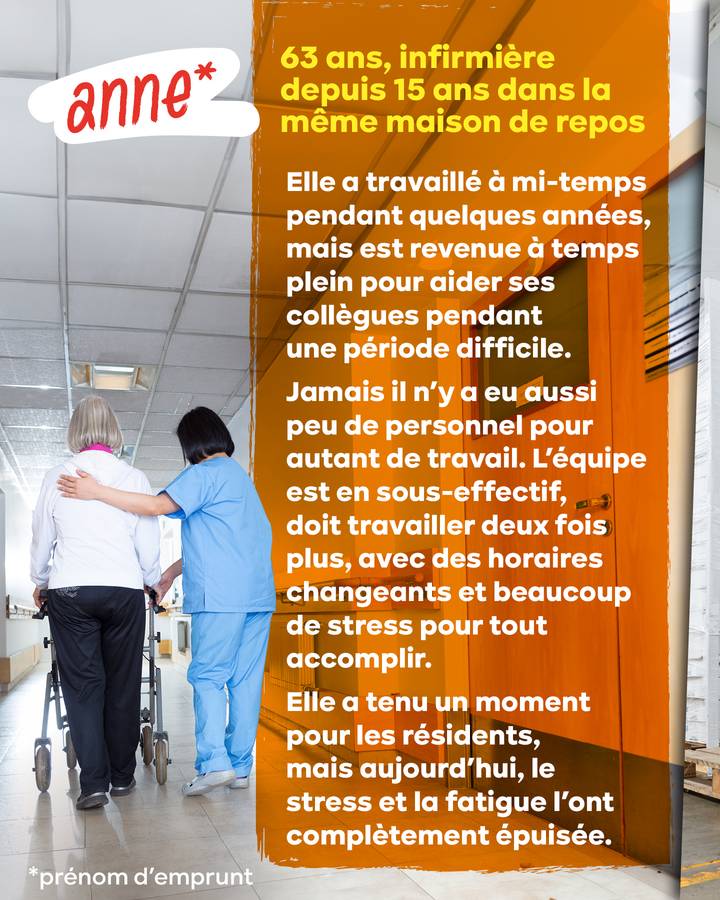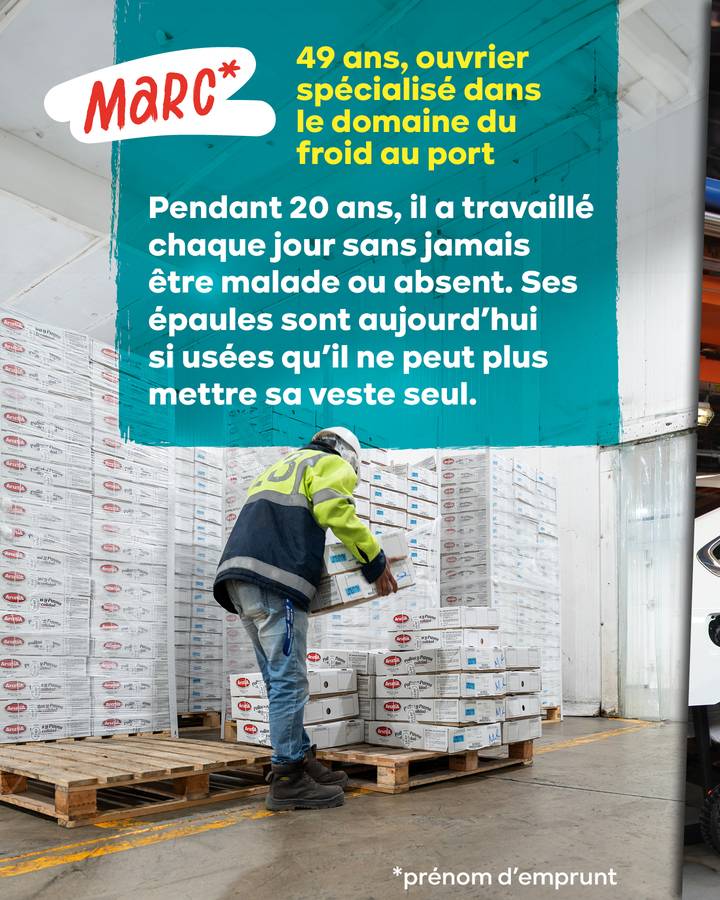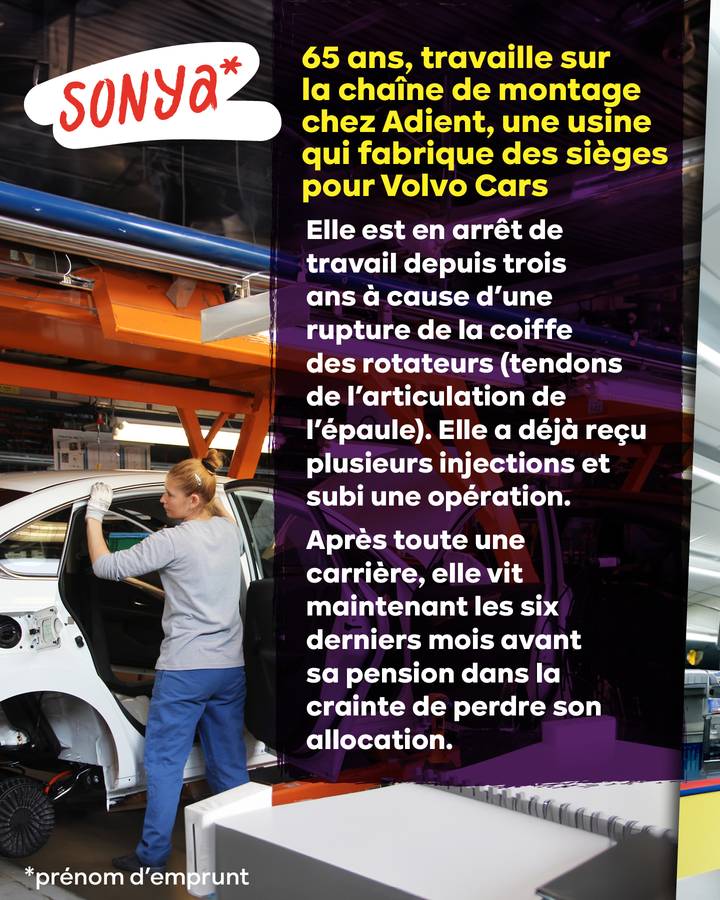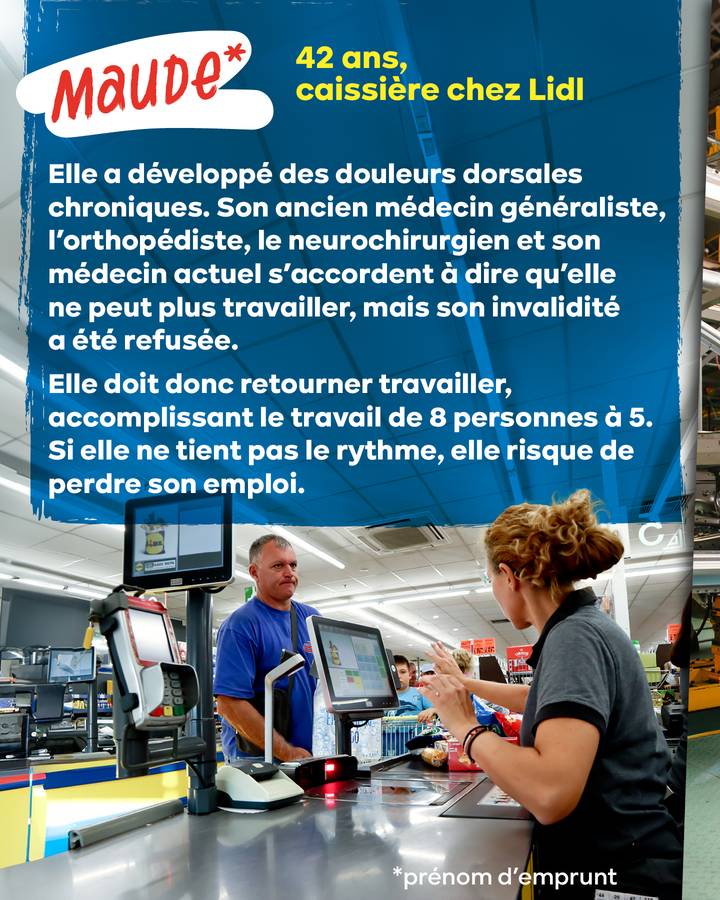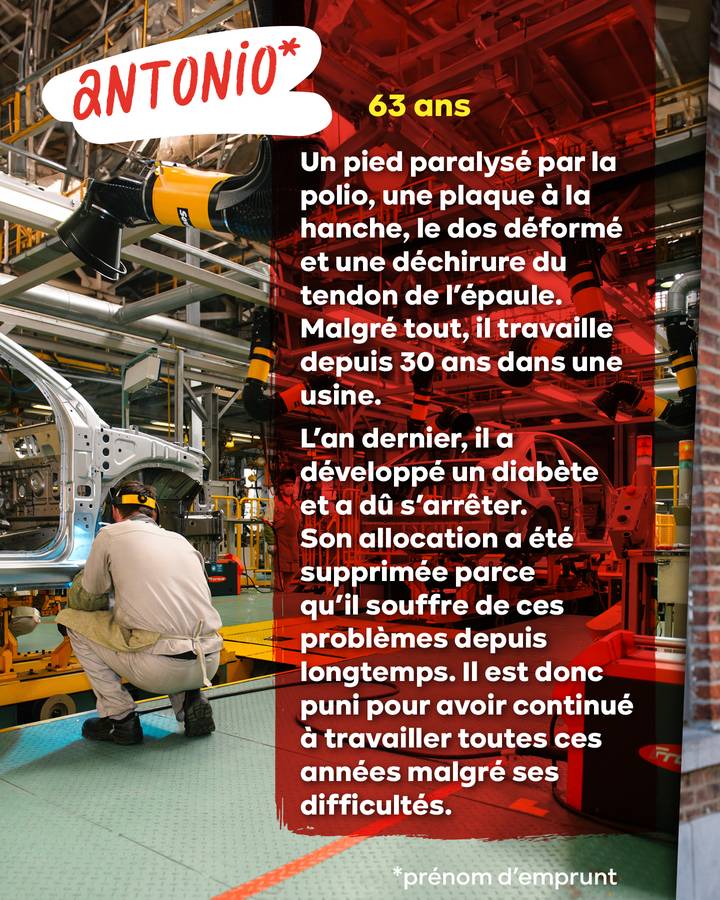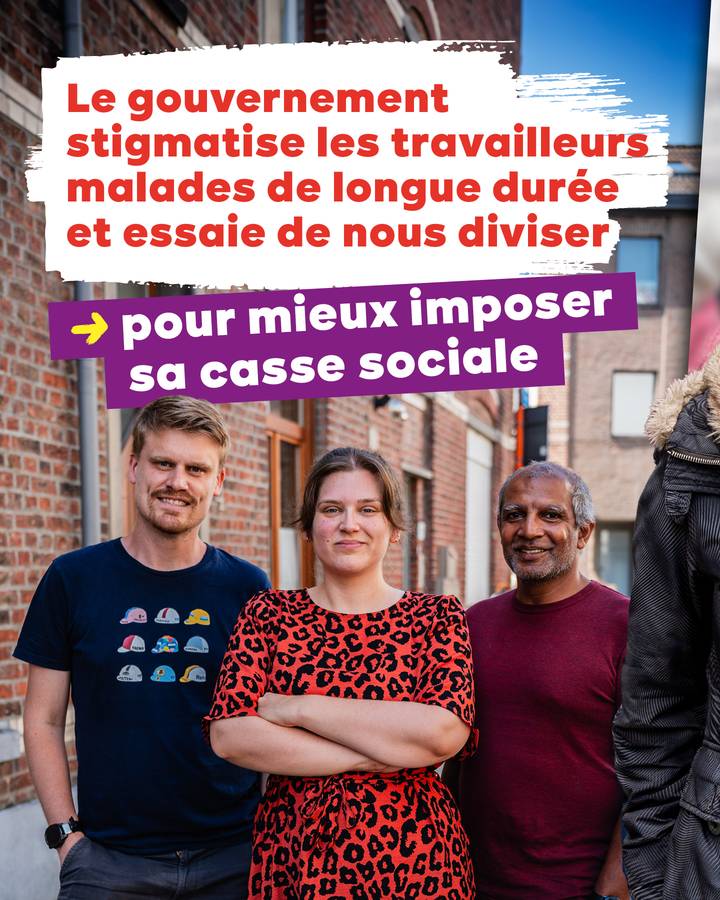Les malades sont imaginaires uniquement dans la tête de George-Louis Bouchez
De Frank Vandenbroucke à Georges-Louis Bouchez, tout le monde est d’accord dans le gouvernement Arizona pour faire des économies sur ce qu’on appelle les travailleurs malades de longues durée. Selon le gouvernement De Wever-Bouchez, une grande partie d’entre eux et d’entre elles seraient des malades imaginaires ou des malades qui pourraient quand même retourner sur le marché du travail. Mais qu’en est-il ? Quelle est la réalité concrète des travailleurs et travailleuses malades ?
Article par Elisa Munoz Gomez, vice-présidente de Médecine pour le peuple
& Sofie Merckx, cheffe de groupe du PTB au parlement fédéral
300 000 malades de longue durée supplémentaires qui ne tombent pas du ciel
La Belgique compte aujourd’hui plus d’un demi-million de travailleurs en incapacité de travail depuis plus d’un an. C’est deux fois plus qu’en 2010. Autrefois, il s’agissait surtout de personnes en convalescence après un infarctus ou un cancer. Aujourd’hui, il est surtout question de femmes et d’hommes souffrant d’usure physique ou de troubles psychiques liés au stress. Les troubles musculosquelettiques et les affections psychiques liées au stress représentent aujourd’hui plus des deux tiers du total des malades de longue durée1. Dans les deux cas, l’origine du mal est principalement à trouver dans le travail du malade.
Une telle explosion du nombre de malades – près de 300 000 malades de longue durée supplémentaires en 15 ans – ne peut s’expliquer car ils auraient subitement été frappés d’imagination ou parce que le pays compteraient une armée subite de profiteurs. La réponse à cette explosion est bien entendu à chercher ailleurs. Ce que De Wever, Bouchez et Vandenbroucke ne veulent pas faire.
Qu’est-ce qui a changé ces dernières années ? Essentiellement deux choses :
D’abord, on a repoussé toujours plus les possibilités de partir en pension ou en prépension.
Ensuite, la charge de travail, la flexibilité, la pression au travail et la précarité du travail n’ont cessé d’augmenter. Intensification des cadences, flexibilité permanente, pression des résultats et peur de perdre son emploi ont profondément transformé la relation au travail.
Ce sont sur ces éléments qu’il faut se pencher pour comprendre ce que nous vivons aujourd’hui. Nous ne devons pas tellement nous pencher sur la personnalité des malades mais sur les conditions qui rendent les travailleurs et travailleuses du pays toujours plus malades.
Alerte Fake News
Le gouvernement Arizona répète à longueur de journée que l’Allemagne a autant de malades de longue durée que la Belgique alors que l’Allemagne est sept fois plus peuplée. Ceci est tout simplement faux, comme l’a d’ailleurs confirmé un fact check de la RTBF2. Tout d’abord il n’existe pas de chiffres en Allemagne sur le nombre de malades de longue durée (plus d’un an d’incapacité) donc il est difficile de comparer les deux pays. Les seuls chiffres qui existent concernent les personnes inactives pour cause de maladie ou de handicap, quelle que soit leur durée d’incapacité. L'Allemagne compte environ 2 millions de malades, soit deux à quatre fois plus de malades en Allemagne qu’en Belgique.
Autre argument qu’on entend souvent : « une étude de l’INAMI montrerait qu’un quart des personnes en invalidité jusqu’à la pension sont de faux malades ». Fake news, tranche Le Soir3, qui a vérifié cette affirmation. Il ne s’agit pas de données représentatives – elles ne peuvent pas être généralisées –, ce que le ministre Vandenbroucke a lui-même reconnu. Ces chiffres ont été délibérément divulgués à la presse, au moment même où le gouvernement cherche à économiser des milliards. En d’autres mots, il s’agit de chiffres délibérément manipulés et récupérés politiquement pour essayer de justifier de nouvelles économies sur le dos des travailleurs malades.
Les malades de longue durée sont principalement des ouvriers, des femmes et des travailleurs âgés
Derrière ces malades, on trouve principalement des ouvriers, des femmes et des travailleurs de plus de 55 ans. Voyons plus en détail leurs réalités :
Les ouvriers : ils ont deux fois plus de risques d’être en invalidité que les employés. Leurs métiers – manutention, nettoyage, construction, soins, industrie – usent le corps bien avant l’âge légal de la pension. Ils et elles commencent aussi leur carrière plus tôt que les diplômés et ont donc leur corps usés plus tôt.
Les femmes : elles représentent près de 60 % des malades de longue durée. Elles occupent des secteurs tels que : soins de santé, aide-soignante, titres-services, supermarchés, etc. Ces secteurs sont tout particulièrement pénibles. Il s’agit de porter des personnes, tirer des chariots lourds, mettre en rayon, répéter les mêmes mouvements à longueur de journée et toujours plus vite. À cela s’ajoute la charge mentale liée à la gestion de l’humain fort présent dans ces métiers : le malade, la personne âgée chez qui on va nettoyer, le client du magasin. Et tout cela s’ajoute bien souvent à la charge de la famille et du foyer. On parle souvent de « double journée de travail ». Finalement, ces secteurs sont essentiels à la société mais peu valorisés et les salaires y sont souvent bas à très bas. Selon un rapport Securex4, un travailleur à temps partiel a aujourd’hui près de deux fois plus de risque d’être absent de longue durée comparé à un collègue à temps plein.
Les travailleurs et travailleuses de plus de 55 ans : c’est la tranche d’âge la plus représentée. 64 % des malades de longue durée ont plus de 50 ans et 47 % ont plus de 55 ans (chiffres INAMI5). C’est tout sauf un hasard : ce sont les générations directement touchées par la suppression progressive des prépensions et le relèvement de l’âge de la pension. Autrefois, un travailleur fatigué pouvait quitter dignement le monde du travail à 58 ou 60 ans. Aujourd’hui, il doit tenir toujours plus longtemps – parfois dans des postes qui exigent des gestes répétitifs, le port de charges, ou des cadences que le corps ne supporte plus. Pour le secrétariat social Securex, ce n’est pas une surprise : « Davantage de personnes âgées sont au travail et doivent travailler plus longtemps, ce qui entraîne une augmentation de l’absentéisme pour maladie. Chez les ouvriers, cet effet est plus marqué que chez les employés. Ils subissent en effet une charge physique plus lourde, qui pèse davantage lorsqu’ils doivent travailler plus longtemps. »
Paul, Maria et Marc, les visages des travailleurs et travailleuses malades
Mais plus encore, derrière ces chiffres, il y a des femmes et des hommes qui font tourner notre société et que le gouvernement De Wever-Bouchez tente d’invisibiliser. Derrière ces chiffres, on parle de Paul, Maria et Marc.
Paul, 63 ans, ouvrier du bâtiment : « J’ai travaillé toute ma vie dans le bâtiment. Au début, j’aimais ce métier : le travail bien fait, le concret, la satisfaction en fin de journée. Mais ces dernières années, tout est devenu plus dur à suivre. On me demandait d’aller sur plusieurs chantiers par jour, de me lever toujours plus tôt, de tout faire plus vite. Les journées n’en finissaient pas, les horaires changeaient tout le temps… et avec un chef toujours sur le dos, ça devenait invivable. J’ai commencé à mal dormir, puis plus du tout. J’étais épuisé, vidé. Depuis le début de 2022, je suis en arrêt. J’ai le dos et les épaules en miettes, et, franchement, je n’ai plus d’énergie. Je suis au bout du rouleau. »
Maria, 57 ans, aide-ménagère à Charleroi : « J’ai travaillé pendant des années comme aide-ménagère, à temps plein. Tous les jours, je faisais plusieurs maisons, souvent à mi-temps dans chacune. Entre les deux, pas de vraie pause : juste le temps de courir d’un endroit à l’autre, parfois sans même manger. À force, j’ai commencé à avoir mal à l’épaule. D’abord une tendinite, puis une déchirure. J’ai été opérée, j’ai fait de la kiné, mais la douleur ne me quitte plus. Et le plus difficile, c’est qu’en rentrant chez moi, le travail continuait. Il fallait encore s’occuper de la maison, des repas, de la famille. J’avais l’impression de mener une double vie : celle où je nettoyais chez les autres, et celle où je continuais à tout faire chez moi. Depuis 2021, je suis en incapacité. Mon corps a dit stop. Mais dans ma tête, j’ai encore du mal à accepter que tout ce que j’ai donné m’ait usée à ce point. »
Marc, 49 ans, travailleur de la logistique au port d’Anvers : « Ça fait plus de vingt ans que je travaille dans le froid, au port. Un métier dur, physique, mais j’ai toujours aimé bien faire les choses. Pendant toutes ces années, je n’ai jamais été malade, jamais absent. J’étais fier de ne jamais rien lâcher.
Mais aujourd’hui, mon corps ne suit plus. Mes épaules sont complètement usées. Rien que pour enfiler ma veste, j’ai besoin d’aide. Certains jours, je n’arrive même plus à lever les bras au-dessus de la tête.
Quand j’entends qu’on devra travailler jusqu’à 67 ans, je me demande comment c’est possible. Moi, à 49, je suis déjà à bout. Ce n’est pas que je ne veux pas travailler plus longtemps, c’est juste que je ne peux plus. Mon corps a donné tout ce qu’il pouvait. »
Paul, Maria et Marc ne pourront jamais tenir jusqu’à 67 ans. Les forcer à travailler plus longtemps, sans possibilité d’aménagements de fin de carrière ou de prépension, conduit inévitablement à des arrêts maladie de longue durée.
Rétablir des mécanismes de pension anticipée est une condition essentielle pour faire baisser le nombre de malades de longue durée
Pendant des décennies, la prépension servait de soupape : elle permettait aux travailleurs âgés de quitter le travail avant l’usure totale. Mais depuis les réformes des années 2000, cette issue s’est progressivement refermée. Ce que les statistiques appellent « malades de longue durée » correspond souvent aux anciens prépensionnés, déplacés d’une case à une autre dans le grand tableau de la sécurité sociale. Comme Marc, contraint d’arrêter son travail avec un dos cassé et de basculer sur la mutuelle. La suppression des prépensions et le relèvement de l’âge de la retraite ont eu un effet mécanique : le nombre de personnes reconnues invalides a explosé. Comme l’a montré Kim De Witte, spécialiste pensions du PTB, dans son dernier livre, il y a un rapport presque de un pour un entre la diminution du nombre de prépensionnés et l’augmentation de travailleurs malades de plus de 55 ans.
Le gouvernement chasse les malades, mais ne fait rien pour chasser la maladie
Être « en invalidité » n’a rien d’un privilège : les revenus diminuent, les droits sont fragilisés et le regard social pèse lourd. Beaucoup vivent ce passage comme une relégation, un statut qui n’offre ni repos ni reconnaissance. Le burn-out, les douleurs chroniques, les dépressions et les troubles anxieux se multiplient, notamment dans les métiers du soin, de la logistique, du nettoyage ou de la grande distribution : ceux qui ont tenu le pays debout pendant la pandémie. Mais que font les Bouchez et Vandenbroucke de ce monde ? Ils ne montrent aucun respect pour ces travailleuses et ces travailleurs. Ils ne s'attaquent pas aux véritables causes qui rendent Marc, Maria et Paul malades. Il préfère les sanctionner, les harceler pour qu’ils reprennent le travail sans être guéris. Comme si des problèmes de dos, des tendinites aux épaules ou des dépressions pouvaient disparaître par magie. L’objectif n’est évidemment pas de permettre à ces travailleurs de retrouver la santé ni de revenir dans un emploi respectueux de leur corps. Non, le but est simple : économiser 1,8 milliard d’euros… sur leur dos.
Et ce n’est pas tout. Le gouvernement Arizona envisage de généraliser le travail de nuit, d’étendre les « flexijobs » à tous les secteurs et de faire travailler chacun jusqu’à 67 ans. Le seul résultat possible ? Toujours plus de travailleurs et travailleuses malades. Marc, Maria et Paul aiment leur métier, mais pour quoi et pour qui devraient-ils sacrifier leur santé ? Pour finir leur carrière épuisés, brisés, incapables de profiter d’un repos bien mérité à la fin de leur vie ?
Pour mener ces politiques antisociales, le gouvernement a besoin de stigmatiser les travailleurs malades. Il a besoin qu’il y ait une forme de suspicion généralisée envers tous les travailleurs malades de longue durée. Mais cette suspicion et cette stigmatisation nuit gravement à l’intégration au travail. Quand on n'est pas bien, à la maison, le fait de se sentir coupable n’aide pas à la guérison, tout le contraire.
Tant que l’on ne s'attaque pas aux véritables causes de la maladie au travail – surcharge, cadences impossibles, horaires démentiels, manque d’aménagements pour les carrières longues… –, rien ne changera. Il ne s’agit pas de sanctionner ou de stigmatiser les travailleurs malades, mais de mettre en place de réelles mesures de prévention, de repenser les conditions de travail et de respecter la santé de ceux qui font tourner le pays.
- Incapacité de travail de longue durée (i40) » sur Bureau fédéral du Plan / Institut national d’assurance maladie‑invalidité : https://indicators.be/fr/i/G08_WIN/Incapacit%C3%A9_de_travail_de_longue_dur%C3%A9e_(i40)
- https://www.rtbf.be/article/autant-de-malades-de-longue-duree-en-belgique-qu-en-allemagne-c-est-faux-meme-si-la-belgique-est-le-plus-mauvais-eleve-europeen-11538147
- https://www.lesoir.be/705633/article/2025-10-17/vrai-ou-faux-un-quart-des-personnes-reconnues-en-invalidite-jusqua-la-pension
- L’absentéisme de longue durée atteint à nouveau un niveau record’, Securex, 23 octobre 2025, https://press.securex.be/labsenteisme-de-longue-duree-atteint-a-nouveau-un-niveau-record
- https://www.riziv.fgov.be/SiteCollectionDocuments/1-2_aantal_personen_invaliditeit_burnout_depressie_2018_2023_leeftijd.pdf